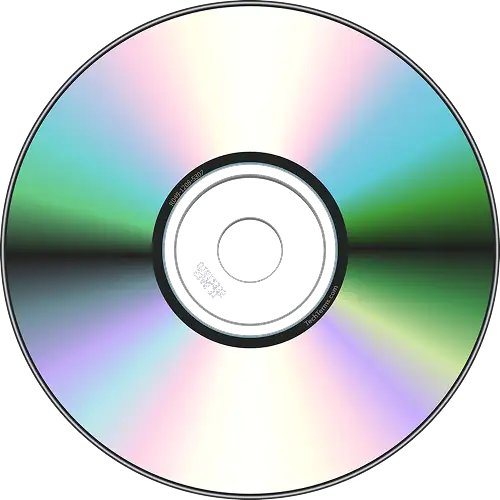Utiliser les médias sociaux
Partager du contenu de la campagne sur les réseaux sociaux de votre établissement permet de lui donner vie localement et de rejoindre un maximum d’étudiant·e·s.
Du contenu clé en main vous sera fourni : visuels, textes (captions), plateformes recommandées, etc. Il ne restera qu’à le publier!
Cela dit, en diffusant la campagne, il est possible que vous receviez des messages de la part des étudiant·e·s, comme des questions sur le dépistage, le port du condom, des réactions ou des demandes de soutien.
C’est pourquoi il est important de prendre connaissance des bonnes pratiques en matière de gestion de communauté avant la mise en ligne. Nous vous donnons le maximum d'informations, mais n'hésitez -pas à les adapter en fonction de vos besoins et ressources!
Bonnes pratiques de la gestion de communauté
Profiter de la campagne pour interagir avec la communauté étudiante
La campagne est l’occasion en or pour vous de répondre aux questions et d’offrir des renseignements personnalisés à chaque étudiant·e qui vous sollicite sans tabou au sujet du dépistage et des ITSS.
Cependant, comme parler de sexualité sur les réseaux sociaux fait jaser, vous risquez d’avoir des réactions sur les publications. Voici nos bonnes pratiques en matière de gestion de communauté.
Veille régulière des réseaux sociaux
C’est important de répondre, dans la mesure du possible, à toutes les questions qui vous sont posées. Pour ce faire, nous vous recommandons de consulter vos réseaux sociaux fréquemment lorsque vous partagez un contenu de la campagne. C’est la clé pour éviter les débordements!
Pas besoin d’y passer des heures : le plus important est de le faire régulièrement. 10 à 15 minutes chaque jour ou un jour sur deux, c’est idéal pour éviter de laisser les étudiant·e·s sans réponse trop longtemps.
Utiliser un langage adapté et inclusif
Il est recommandé d’adopter un langage inclusif pour que chaque personne se sente reconnue. Nous recommandons également de ne jamais présumer de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou des organes génitaux d'une personne.
Adapter le ton
Les personnes étudiantes ont des connaissances différentes sur la santé sexuelle. Il est donc important de garder un langage vulgarisé et adapté (par exemple, évitez d’utiliser des termes trop scientifiques). Nous recommandons également d’utiliser un ton accessible et non moralisateur.
Répondre aux messages privés
Commencer par dire bonjour et ajouter le nom de la personne (afin de permettre une personnalisation pour que la personne se sente écoutée).
- Adopter une attitude positive, bienveillante, ouverte et sans jugement. Nous voulons que la personne se sente accueillie et sente qu’elle a l’espace pour s’ouvrir.
- Comprendre la position de la personne (par exemple : « On comprend ta position, on entend ta remarque, ton point de vue est important pour nous. »).
- Faire des erreurs, ça arrive à tout le monde! Si vous constatez que vous avez mal compris ce que la personne vous a partagé ou si vous lui avez donné une information ou un conseil erroné ou inadapté, pas de panique : vous pouvez lui présenter des excuses et lui demander de clarifier sa demande (par exemple : « Nous venons de voir que les horaires du dépistage ne sont pas les bons, notre erreur! Voici les horaires mis à jour : … »)
- Émettre des recommandations adaptées aux besoins et à la demande de la personne.
- La remercier pour avoir pris le temps de vous écrire et l’encourager à vous réécrire si elle a d’autres questionnements.
- En profiter pour donner des informations complémentaires à la situation de la personne et la rediriger vers le site de Oh ouiii quand cela est pertinent.
Répondre aux commentaires publics
Dans la mesure du possible, répondre à tous les commentaires. En effet, les commentaires permettent d’avoir un échange public avec les étudiant·e·s et de partir des discussions (plus il y a de commentaires, plus il y a d’engouement et plus le contenu reçoit de visibilité). Ils permettent également un espace d’éducation collective, une façon secondaire mais efficace de diffuser de l’information.
Il est important de répondre rapidement pour éviter de laisser une situation escalader entre les internautes ou avoir l’air détaché·e, voire désintéressé·e de la situation. Là encore, pas besoin d’y passer des heures, ce qui compte, c’est de le faire régulièrement (au moins une veille par jour si possible).
Si un commentaire fait le partage d’une expérience négative ou aborde des sujets jugés sensibles, prendre action et inviter la personne à nous écrire en message privé. Par exemple : « Merci d’avoir pris le temps de partager ton expérience. N’hésite pas à nous écrire dans nos messages privés si tu aimerais en discuter ».
Supprimer les commentaires si vous observez :
- Incitation à la violence et/ou à des actes criminels envers une personne, un groupe ou une organisation;
- Propos haineux ou incitant à la haine fondés sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, les croyances religieuses ou l’appartenance à une minorité. À noter qu’il y a une possibilité d’instaurer des filtres sur certaines plateformes pour filtrer les commentaires incluant certains mots;
- Langage offensant (possibilité de créer une liste interne de termes jugés offensants pour guider la modération);
- Commentaires incluant des hyperliens jugés dangereux ou douteux;
- Aucun contenu ne doit porter atteinte à une personne, à sa réputation ni viser un groupe ou une organisation de façon discriminatoire;
- Dévoilement d’informations personnelles telles que des numéros de téléphone, courriels ou toute donnée sensible.
Annoncer une journée de dépistage sur les réseaux sociaux
On vous partage une publication à utiliser pour promouvoir la tenue d’une journée de dépistage dans votre établissement.
Nous avons conçu la publication pour être personnalisable et vous permettre d’ajouter facilement les informations nécessaires:
- Date
- Heure
- Lieu
Comment personnaliser l’affiche
- Téléchargez et ouvrez le fichier .
- Cliquez sur le bas de l’image et ajoutez votre texte ( date, lieu, etc.) dans les zones prévues.
- Enregistrez la publication avec vos modifications.
- Publiez sur les réseaux sociaux de votre établissement !
Voici également la caption que vous et la date à publier, vous aurez tout clé en main afin de faciliter le tout! :
« Oh ouiii ! 🎉 Journée de dépistage au cégep ! Passe nous voir entre … et … pour un dépistage rapide, confidentiel et sans jugement. On t’attend au local …. pour prendre soin de ta santé sexuelle ! »
Repartager du contenu Oh ouiii
Comme la campagne Oh ouiii aura ses propres comptes sur Instagram et TikTok, n’hésitez pas à repartager ses contenus sur vos réseaux sociaux. C’est un geste simple, rapide et peu demandant qui contribue à faire rayonner la campagne dans votre établissement. Cela ne nécessite pas de création de contenu supplémentaire de votre part.
Banques de questions et réponses
Certain·e·s étudiant·e·s peuvent poser des questions dans les commentaires ou en messages privés suite aux publications sur les réseaux sociaux. Si la question est d’ordre général et que la réponse peut bénéficier à tout le monde, vous pouvez y répondre directement en commentaire.
Cependant, si la question touche à la vie intime ou personnelle de la personne, il est préférable de répondre de manière générale et de proposer de s’adresser à la personne ressource de son établissement (service de sexologie, intervenant·e en santé sexuelle, etc.). Le but n’est pas de faire de l’intervention individuelle par message privé, mais plutôt de saisir les occasions pour transmettre de l’information fiable, rassurante et bienveillante.
Votre rôle est d’informer, de démystifier et de rassurer. N’hésitez pas à aborder les craintes qui peuvent se cacher derrière certaines questions, car le dépistage d’ITSS peut être une expérience nouvelle, parfois anxiogène ou associée à des expériences de victimisation pour certain·e·s.
Vous trouverez ci-dessous une liste de questions fréquemment posées et leurs réponses, liées au dépistage d’ITSS et au port du condom. Vous pouvez vous inspirer directement des réponses fournies, tout en adaptant votre contenu si nécessaire. Des notes à l’intention des intervenant·e·s, entre parenthèses et en italique, donnent un contexte supplémentaire pour chaque question.
Une FAQ complète est disponible sur le Dépistapp. N’hésitez pas à y référer.
Questions et réponses liées au dépistage
Q : Est-ce que je devrais aller me faire dépister?
R : Vite comme ça, on peut pas le dire. Ça dépend de plusieurs facteurs, comme tes pratiques et ton historique. Tu peux compléter un court questionnaire pour connaître tes besoins en termes de dépistage.
(Note à l’intervenant·e : Les étudiant·e·s pourraient partager davantage sur les raisons derrière leur questionnements, et vous partager d’emblée leur expériences sexuelle récentes. Bien qu’on recommande toujours un dépistage, évitez d’évaluer vous-même leur besoin de dépistage. Orientez-les plutôt vers le questionnaireprévu à cet effet, conçu en collaboration avec des professionnel·le·s de santé sexuelle pour offrir une évaluation appropriée.)
Q : Est-ce que ça fait mal de se faire dépister?
R: C’est une question super légitime, surtout si c’est ta première fois. En général, non, le dépistage ne fait pas mal. Certains prélèvements, comme l’urine ou les sécrétions (gorge, vagin, anus), peuvent être un peu plus inconfortables, mais pas douloureux. Le prélèvement sanguin peut piquer un peu, comme une prise de sang normale.
Bref, c’est généralement rapide et peu douloureux. Et surtout, c’est un petit geste qui fait une grande différence pour ta santé sexuelle.
(Note à l’intervenant·e : Le dépistage peut sembler intimidant ou inconfortable, surtout pour une première fois. Souvent, derrière cette question se cache un besoin de réassurance et de clarté : les étudiant·e·s veulent comprendre ce qu’implique un dépistage et à quoi s’attendre concrètement.)
Q : Est-ce qu’il faut que je le dise à mes partenaires que j’ai une ITSS?
R: Même si dévoiler qu’on a une ITSS peut faire peur, c’est important de le dire à tes derniers partenaires si tu as reçu un résultat positif d’ITSS, afin de réduire les risques de transmission:
La personne pourra se faire dépister à son tour pour déterminer si elle aussi aura besoin de traitement ;
Si tout le monde est au courant, ce sera bien plus facile de mettre en place des stratégies de protection, comme l'abstinence jusqu’à la fin du traitement ou l’utilisation de méthode de protection, comme le condom ou la digue sexuelle. Même si ça semble difficile d’en parler, tu risques de te sentir mieux et soulagé·e après!
(Note à l’intervenant·e : Si la personne a besoin d’outils pour annoncer un résultat positif, vous pouvez lui partager notre article Dévoiler un diagnostic positif d’ITSS : les dos and don’ts. Prenez le temps d’explorer avec elle ses craintes et ses blocages.
Si un dévoilement direct la met en danger ou qu’elle ne s’y sent pas prête, orientez-la vers des ressources anonymes comme le service de notification des partenaires du Portail VIH/sida du Québec.
À savoir : en cas de VIH, il existe une obligation légale de divulguer sa séropositivité avant une activité sexuelle lorsqu’il y a une « possibilité réaliste de transmission ». Plus d’info sur cet enjeu légal sur le site de COCQ-SIDA.
Q : Est-ce que j’ai besoin de me faire dépister si je suis en relation exclusive?
R : Même si tu n’as eu qu’un·e seul·e partenaire, qui n'a que toi comme partenaire, la monogamie ne compte pas comme méthode de protection efficace contre la transmission des ITSS. Ton ou ta partenaire et toi pourriez tout de même être à risque pour plusieurs raisons :
- Vous avez arrêté d’utiliser des méthodes de protection avant d’avoir tous les deux passé un test de dépistage.
- Si l’un·e de vous a une ITSS mais que vous n’avez pas de symptômes, il est possible de la transmettre sans le savoir, et ce , même après ben ben du temps.
- S’il y a de l’infidelité dans votre relation;
- Si vous avez été exposé·e·s aux ITSS d’autres façons que les relations sexuelles, comme par un tatouage ou perçage avec des aiguilles non stériles ou en consommant des drogues par injection ou par inhalation.
(Note à l’intervenant·e : L’objectif n’est pas de semer la peur chez les couples monogames, mais de rappeler que le dépistage reste important, même dans ce type de relation. Les données montrent qu’on associe souvent un risque faible, voire nul, d’ITSS en contexte monogame, alors qu’en réalité, ce risque n’est pas inexistant. Vous aurez peut-être à accompagner une personne en relation monogame dans le dévoilement à son partenaire. Vous pouvez consulter nos articles «Plus de partenaires, plus de chances d’avoir des ITSS?» et «Dévoiler un diagnostic positif d’ITSS : les dos and dont’s »)